Ce bâtiment est vieux de 5 siècles. Il fut une seigneurie de moyenne et de basse justice au 15 ème siècle.
Ce bâtiment est vieux de 5 siècles. Il fut une seigneurie de moyenne et basse justice au 15 -ème siècle

Le domaine comprenait un logis principal, une maison à four, écurie et étable.
Sur le domaine, un moulin à eau et un colombier qui n’existent plus à ce jour.
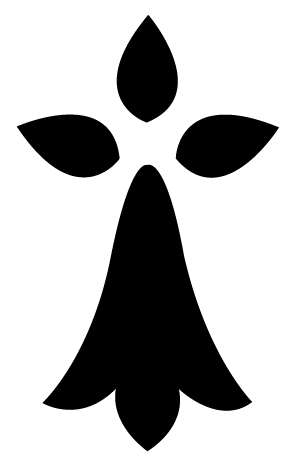

Le manoir de Kerdeval se dotait aussi d’une chapelle, sous le patronage de Saint Sébastien. Cette chapelle existait déjà en 1630. Elle fut détruite en 1786.
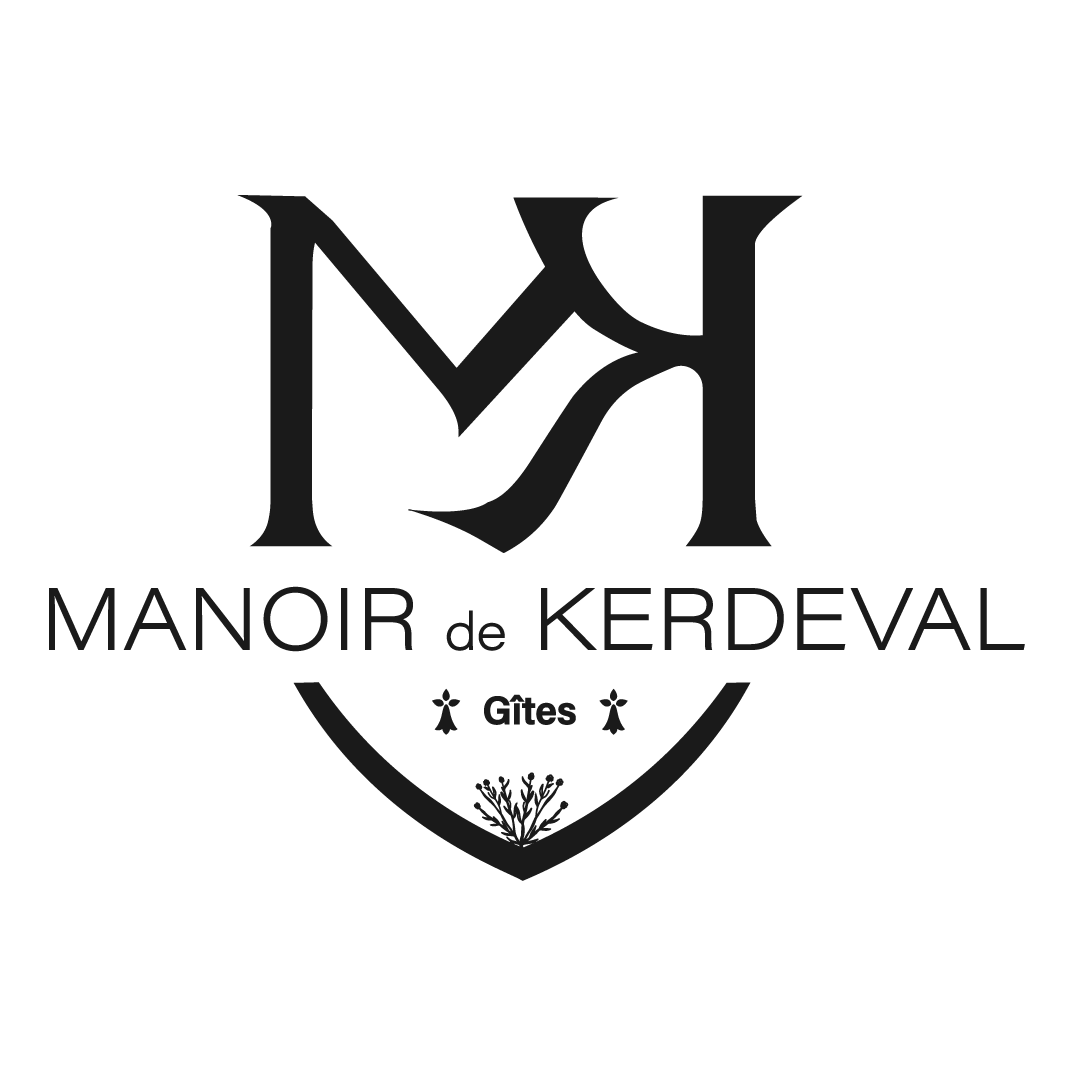
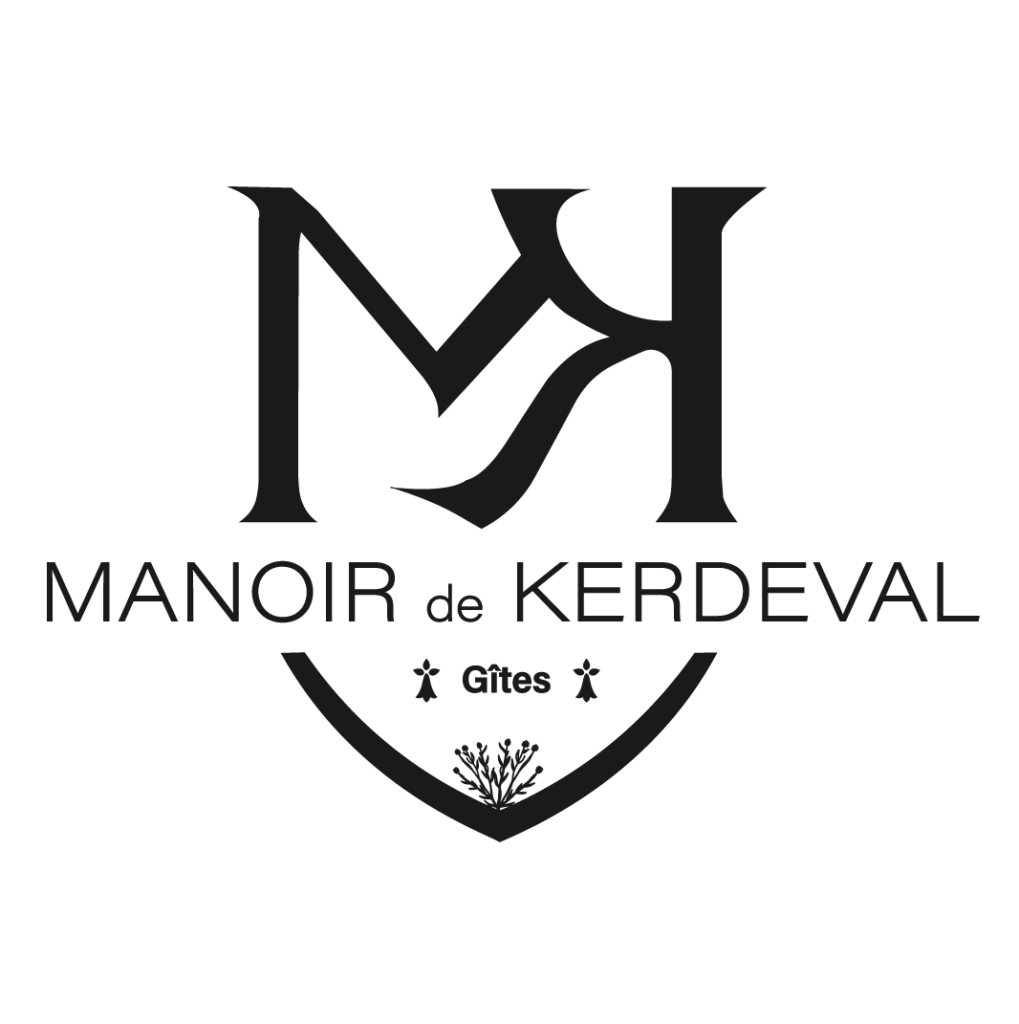


Le Seigneur Lezhildry donne le manoir à un Monsieur Balcou sous forme d’un domaine congéable.
Sur la parcelle existent toujours 3 routoirs.
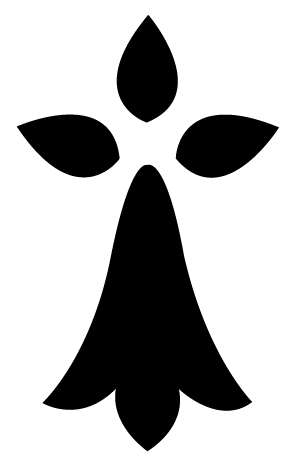

Qu’est-ce qu’un routoir, ou roussoir en breton ?
Les techniques de rouissage et de séchage du lin et du chanvre. (Selon le dossier IA29010102 de l’inventaire du patrimoine culturel de Bretagne).
Suite à l’arrachage et une fois débarrassées de leurs graines, les tiges de lin et de chanvre, font l’objet d’une opération particulière, qui, si elle est bien menée, va permettre de faciliter l’extraction des fibres textiles.
Le rouissage consiste à laisser macérer dans l’eau les gerbes ou les tiges de lin et de chanvre, afin de dissoudre, sous l’action de micro-organismes, le ciment (pectose) qui lie les fibres au bois situées au centre du brin. Pour ce processus, les gerbes sont immergées dans l’eau stagnante ou courante d’un bassin ou d’un cours d’eau, ou s’étendent sur le sol et exposées à la pluie et à la rosée. Le rouissage dit « en eau vive » est préféré car il est réputé permettre un « nettoyage » de meilleure qualité et une altération moindre des fibres. Suivant cette méthode, un radeau de bois est placé dans le lit d’une rivière et maintenu à la terre ferme par une corde, sur laquelle seront disposées les poignées de chanvre côte à côte et lit après lit. Il faut ensuite charger cette sorte de barge à l’aide de pierres de Lourdes. Le rouissage peut alors débuter. Cette immersion dure de 5 à 15 jours selon le climat et la température de l’eau et exige une surveillance attentive afin d’être stoppée avant la dégradation des fibres textiles.
Cependant, le territoire géologique de l’ouest de la Bretagne étant argileux et riche en eaux de surface, le rouissage en bassin a été privilégié. Ainsi, des réservoirs maçonnés ou non, de tailles variables, alimentés par des sources ou ruisseaux à faible débit ont été construits partout où il y en avait besoin, suivant la particularité des terrains. Différents noms sont donnés à ces bassins à rouir selon la langue utilisée dans le territoire concerné : poull-lin, routoirs, rouissoirs, douets à rouir… Comme pour le rouissage en rivière, le lin ou le chanvre sont rassemblés en bottes de plongée et traités à la fleur d’eau à l’aide de planches de bois lestées de pierres ou de galets. La définition et les pratiques liées à nous et aux autres restent encore à affiner.
Bien que populaire, ce procédé présente un désagrément important ; la concentration en azote entraîne une pollution des eaux, l’émanation d’odeurs nauséabondes, la destruction de la faune et porte atteinte à la santé des rivières. Ainsi, dans les Côtes d’Armor, plusieurs arrêtés préfectoraux (en 1896 et 1909 notamment) interdisent de manière définitive le rouissage dans les cours d’eau.
Lorsque la fermentation d’un produit à l’effet désiré, c’est-à-dire décomposée la partie ligneuse située au centre des tiges, les gerbes de lin ou de chanvre doivent être séchées. Celles-ci sont disposées verticalement en petites meules sur place ou dans une prairie à proximité de la ferme. Les poignées sont ensuite regroupées en plus grosses bottes afin d’être rangées dans une grange jusqu’à l’hiver. C’est au cours de cette période que sera effectuée la dernière étape du séchage du chanvre dans le four à pain du hameau ou des fours construits spécialement à cet effet. Ainsi, la dessiccation complète de cette plante plus ligneuse que le lin permet d’effectuer l’opération engagée lors du rouissage : l’élimination définitive des éléments de bois ou de résine.
La prochaine étape, le broyage ou le teillage des gerbes, permettra de libérer totalement les fibres textiles

Notre petit appentis est historique lui aussi.
Sur son toit de tuiles pas comme les autres : à l’origine, des relations maritimes, entre la côte nord de Bretagne et l’Angleterre du sud-ouest. Les tuiles les plus anciennes proviennent de Bridgwater, petit port du Somerset situé non loin de Bristol et de Cardiff, avant l’embouchure de la rivière Severn, qui possède quatre fabriques de briques et de tuiles depuis 1830…. voir l’article sur :
https://www.oceanide-bretagne.fr/Les-toits-en-tuiles-anglaises-du-Tregor-Goelo

J’espère que nous trouverons des tuiles de remplacement car ciaran est passée par là..
